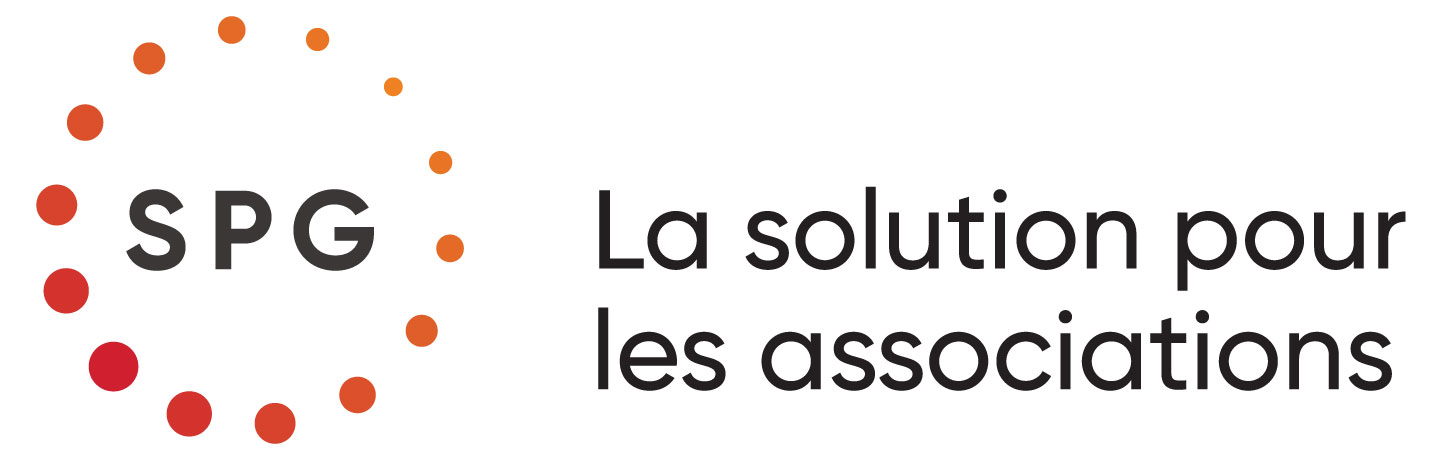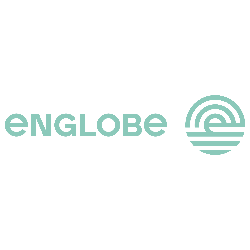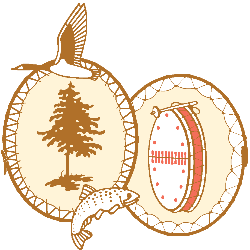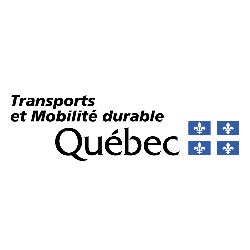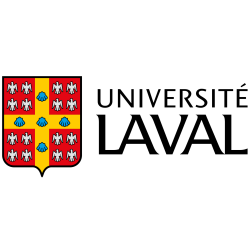Le Gala excellence de l'AQÉI est de retour... et il célèbre ses 35 ans!
|
.gif) |
Formations
14 h 30 à 18 h 00 (Horaire sujet à changement)
Parce que le Gala, c’est plus qu’une soirée! En après-midi, des formations exclusives seront offertes afin de vous permettre de bonifier vos connaissances, nourrir vos réflexions et profiter pleinement de votre présence avant les célébrations. Deux blocs de formation seront offerts simultanément.
Notez que votre sélection devra être précisée lors de l’inscription et ne pourra être modifiée par la suite.
Volet « Biodiversité », présenté en collaboration avec la firme HabitatCette formation immersive de 3 heures permettra de comprendre comment les avancées en biodiversité transforment les pratiques d’évaluation environnementale.
|
|
|
Andrew Gonzalez, Ph. D., fondateur et associé principal d’Habitat, est professeur au Département de biologie de l’Université McGill et directeur fondateur du Centre sur la science de la biodiversité du Québec. Reconnu mondialement pour ses travaux en écologie et en science de la biodiversité, il est un spécialiste de la connectivité écologique et des réseaux naturels. |
Ses recherches portent sur la modélisation de la connectivité actuelle et future des milieux naturels, en fonction de divers scénarios de changements climatiques et d’utilisation des terres. Ces travaux ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques qui font autorité dans le domaine.
Volet « Socio-environnemental »
Durant 3 heures, plusieurs conférenciers se succèderont pour vous faire réfléchir et débattre des enjeux socio-environnementaux actuels.
Thématique 1 : Nouvelles réalités de collaboration avec les Premières Nations et les Inuits
- DIVERSITÉ DES CAPACITÉS ET PRATIQUES COLLABORATIVES AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES EN ÉTUDE D’IMPACT ET STRATÉGIES D’ADAPTIONS DES CONSULTANTS
Les capacités et les priorités en consultation au sein des Premières Nations et des Inuits au Québec se sont transformées significativement au cours des dernières années, notamment dans les études d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux. Différents types de gestion et de pratiques de consultation sont désormais à prendre en compte d’une Nation à l’autre. Pour les consultants, ce nouveau contexte engendre des enjeux opérationnels et corporatifs pour garantir aux clients des études d’impacts qui soient, à la fois, conforment aux requis gouvernementaux et inclus ces nouvelles capacités autochtones. Cette présentation a pour but d’exposer comment WSP gère ces enjeux de collaborations du point de vue des praticiens que des responsables corporatifs.
CONFÉRENCIERS
Laurence Lépine, Spécialiste sénior en relation avec les communautés, et Paul Wattez, Responsable des relations avec les Autochtones - Région du Québec
- Autres informations à venir
Thématique 2 : Évaluation des impacts sociaux et participation publique
- PARTICIPATION PUBLIQUE À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET EFFETS SUR LA DÉCISION : RENDRE COMPTE DE 45 ANS DE PRATIQUE DU BAPE
L’urgence climatique, l’impérative transition énergétique et la multiplication des critiques récentes à l’endroit de la démocratie participative posent la question de la pertinence de la participation publique à l’évaluation environnementale et de ses effets sur la décision. La participation publique : qu’est-ce que ça donne? En d’autres termes, comment mesurer l’influence des dispositifs participatifs sur l’action publique et les grands projets?
Cette présentation propose de rendre compte de la relation entre la participation publique à l’évaluation environnementale et la décision gouvernementale autour de l’expérience du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (BAPE). À partir de l’analyse des données d’une banque de plus de 400 projets, plusieurs variables sont étudiées afin de cerner ce qui compte dans la fabrique de la décision. Le BAPE représente une innovation institutionnelle qui fait partie du paysage quotidien des Québécoises et Québécois depuis plus de 45 ans. Il est régulièrement réclamé par la société civile et incarne la participation publique et la démocratie écologique. Le BAPE est un organisme public et indépendant qui jouit d’une réputation internationale. Prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), il mène des enquêtes et des audiences publiques en matière d’environnement, d’énergie, d’extraction des ressources et d’aménagement du territoire.
La conférence mettra en évidence les conditions institutionnelles mises de l’avant par le BAPE pour favoriser la recherche d’informations de qualité, renforcer la confiance du public et soutenir une participation citoyenne significative dans les processus d’évaluation environnementale, permettant ainsi d’avoir des effets sur la prise de décisions.
Conférencier
|
|
Mario Gauthier (Ph. D. en études urbaines) est professeur titulaire en aménagement et développement des territoires au Département des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais. Ses recherches et enseignements portent sur la planification urbaine et métropolitaine, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation environnementale et la participation publique en environnement, aménagement et urbanisme. |
- Autres informations à venir
Gala Excellence et conférence prestige
Conférence : 18 h 30 à 19 h 30 (Horaire sujet à changement)
.gif) |
Accélérer sans affaiblir : comment la science de la biodiversité doit contribuer à l’évaluation environnementaleDans un contexte où Québec et Ottawa veulent réduire le temps de réalisation des évaluations environnementales, la pression pour « aller plus vite » crée un risque réel. Pourtant, dans une période marquée par l’incertitude géopolitique, la crise du vivant et une dette environnementale croissante, affaiblir les règles n’est pas une stratégie viable. La science de la biodiversité offre aujourd’hui des outils capables d’accélérer les analyses tout en renforçant leur rigueur, à condition d’investir dans la connaissance, les données et la planification territoriale. Plutôt que déréguler, il faut moderniser intelligemment pour concilier prospérité économique, crédibilité, acceptabilité sociale et protection du vivant. ConférencierJérôme Dupras est professeur au Département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Il est aussi titulaire de Chaire de recherche du Canada en économie écologique et de la Chaire UNESCO en économie de la biodiversité. Détenteur d'un doctorat en géographie et d'un postdoctorat en biologie, il est spécialiste de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Il consacre aujourd’hui cette expertise au développement d’Habitat, entreprise qu’il a cofondée et dont la mission est d’accélérer la transition écologique, au Québec comme ailleurs. Sur les scènes musicales de la francophonie, on le connaît aussi en tant que membre des Cowboys Fringants. |
|
Le Gala Excellence se poursuivra avec un délicieux cocktail dinatoire, suivi d’une soirée de réseautage des plus animées. Et pour marquer l’occasion comme il se doit… préparez-vous : plusieurs surprises vous attendent! Nous profiterons également de cette soirée pour remettre la bourse AQÉI 2026 ainsi que trois prix de reconnaissance qui mettront en lumière des membres s’étant particulièrement illustrés : • Prix CARRIÈRE Vous souhaitez proposer une candidature pour l'un des ces prix? Rendez-vous sur la page des Prix de reconnaissance 2026 pour connaître tous les détails. |
 |
Tarifs (taxes en sus)
Profitez du tarif hâtif en vous inscrivant avant le 15 mars inclusivement.
|
MEMBRES RÉGULIERS |
NON-MEMBRES |
MEMBRES RETRAITÉS/ |
MEMBRES ÉTUDIANTS |
|
|
Formation seulement |
Tarif hâtif : 190 $ Tarif régulier : 250 $ |
Tarif hâtif : 250 $ Tarif régulier : 300 $ |
Tarif unique : 110 $ | Tarif unique : 50 $ |
|
Conférence prestige + Gala Excellence |
Tarif hâtif : 95 $ Tarif régulier : 150 $ |
Tarif hâtif : 150 $ Tarif régulier : 200 $ |
Tarif unique : 95 $ | Tarif unique : 35 $ |
|
COMBO : Formations + Conférence prestige + Gala Excellence |
Tarif hâtif : 235 $ Tarif régulier : 350 $ |
Tarif hâtif : 350 $ Tarif régulier : 450 $ |
Tarif unique : 160 $ | Tarif unique : 70 $ |
Devenez partenaire du Gala Excellence de l'AQÉI
Associez votre organisation à cet événement phare qui célèbre l'engagement et l'innovation en évaluation d'impacts au Québec.
En devenant partenaire du Gala des prix de reconnaissance de l’AQÉI, vous soutiendrez ainsi la reconnaissance des pratiques exemplaires tout en vous positionnant comme un acteur clé du milieu.
Découvrez nos différentes offres de visibilités en consultant notre Plan de visibilité 2026.
Merci à nos partenaires!
Grand partenaire |
Partenaire « Platine » |
Partenaire « Or » |
Partenaire du cocktail |
|
|
|
|
|